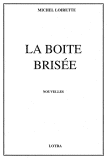L'ANGLAIS
Maria et Marthe habitaient juste à côté de la maison de l'Anglais. Ces deux vieilles filles vivaient dans la petite ferme que leur avaient léguée leurs parents. Elles n'avaient jamais quitté le village. Au lendemain de la grande guerre, elles auraient bien été en âge de se marier mais bien peu de jeunes gens étaient revenus du front. Leurs deux cousins qui avaient à peu près leur âge avaient été tués dans les combats de 1917 et de 1918 et leurs noms, ainsi que tous ceux des disparus figuraient désormais sur le monument aux morts du petit cimetière. Lucien, leur père, volailler de son état, aurait bien voulu leur trouver un parti avant de mourir mais qui serait venu de la vallée sur ces terres éloignées de tout, pour épouser ces deux filles pas très jolies et dépourvues de dot. Habituées aux travaux de la ferme et des champs, elles n'auraient probablement pas voulu quitter un village où elles avaient toujours vécu. Elles se contentaient de ce qu'elles avaient et vivaient des faibles revenus que leur rapportaient les poules, les poulets et les œufs qu'elles vendaient sur le marché de Saint-Affrique. Pour ne pas gaspiller cet argent si durement acquis, elles avaient toujours refusé qu'on leur installât l'électricité et l'eau courante. Elles préféraient tirer l'eau du puits creusé par leurs ancêtres. Quant à l'électricité, elles n'en avaient jamais ressenti l'utilité puisqu'elles vivaient au rythme des saisons, se couchaient quand il faisait nuit et se levaient quand le jour en faisait de même. Tout au plus, consentaient-elles, les soirs d'hiver, à utiliser une vieille lampe à pétrole ou à allumer une bougie. Et puis ne possédaient-elles pas un potager suffisamment vaste pour leur fournir des légumes toute l'année?
L'arrivée du jeune Anglais n'avait d'abord que peu perturbé leur vie. Il avait débarqué un beau matin dans la ferme voisine, abandonnée depuis la mort de sa dernière occupante, Louise Puech. Cette veuve qui avait perdu son mari à la veille de l'armistice de 1918 avait vécu là jusqu'à sa mort dans un isolement presque complet. Les dernières années, elle ne sortait plus de chez elle, se faisant porter par Marthe une soupe et un peu de pain et refusait obstinément d'ouvrir ses volets. Les poules, les oies et les canards vivaient en liberté, grimpaient sur les tables, les chaises et le buffet, fientaient partout. Au fil des mois, la ferme devint une véritable tanière dont l'odeur pestilentielle éloignait tout visiteur. Marthe était restée le seul lien de Louise avec le monde extérieur. C'est elle qui l'avait assistée lorsqu'elle avait attrapé une mauvaise bronchite et qui avait prévenu le curé pour lui administrer les derniers sacrements.
L'enterrrement eut lieu en mars, un jeudi. Bien que l'on fût à quelques jours du printemps la neige tombait à gros flocons et il n'y eut presque personne pour suivre le convoi jusqu'au cimetière. Comme on ne lui connaissait aucune famille, son cercueil fut déposé dans la fosse commune. Ce n'est que quelques mois plus tard que l'on sut qu'elle avait un neveu à Rodez qui avait été fort étonné d'apprendre que sa tante avait fait de lui son légataire universel. Il était venu au village, avait découvert avec horreur la maison. Il n'était pas entré, repoussé par l'odeur et le désordre indescriptible et avait demandé l'aide de gens du pays pour la débarrasser de toutes les ordures qui s'étaient entassées pendant des années. Le déménagement et surtout le nettoyage durèrent plusieurs jours. Lorsque tout fut terminé l'homme de Rodez récompensa les paysans en leur donnant un billet de cent francs, leur offrit une tournée au café puis il remonta dans une vieille frégate et ne revint plus jamais. Il se contenta de mettre la ferme en location. C'est ainsi qu'un jour un homme se présenta. C'était l'Anglais.
Ce garçon d'une vingtaine d'années, très grand, très mince, cheveux longs et barbe rousse qui parlait le français du nord avec un accent britannique fit l'effet d'une apparition. On ignorait qui il était et ce qu'il venait faire ici; certains disaient qu'il était venu de sa lointaine île faire des recherches mais personne ne savait vraiment sur quoi, d'autres murmuraient que c'était un fada comme ceux qui s'étaient installés depuis peu sur le Larzac pour élever des chèvres.
Les Anglais, on en avait rarement entendu parler sinon par l'instituteur qui racontait qu'au Moyen Age ils avaient pillé et brûlé le château; ce souvenir pourtant fort ancien, ajouté à son apparence physique, à ses recherches mystérieuses et à son accent bizarre, rendait, d'emblée, le personnage suspect. Il fut donc accueilli avec méfiance. Pendant plusieurs semaines, on observa attentivement ses faits et gestes et lorsqu'on le rencontrait on se gardait de lui parler d'autre chose que de la pluie et du beau temps. Ses deux voisines le voyaient parfois mais il pouvait rester des journées entières sans mettre le nez dehors. Elles devinaient sa présence parce qu'il laissait toujours une lampe allumée, même en plein jour. Elles en déduisirent que les autres avaient raison, que c'était bien un fada ou qu'il était millionnaire. En tout cas il ne faisait rien pousser dans son jardin et des gens du village l'avaient même vu acheter des salades et des haricots en ville chez un des fils de Charlemagne et on en faisait des gorges chaudes car chacun savait comment ce dernier avait hérité des méthodes de son père!
Il fallut que des poules s'échappent de la basse-cour pour que les deux sœurs fassent davantage connaissance avec notre homme. Il avait timidement frappé à leur porte pour leur signaler l'intrusion des volailles. Elles l'avaient remercié et lui avaient proposé de prendre un café et un verre de tapoueto, cette eau de vie de prune qui vous réveille un mort. Les deux sœurs vivaient dans la même pièce, une grande salle qui servait aussi bien de cuisine que de chambre. Bien que l'on fût en pleine journée, il faisait très sombre. Il avait plu toute la nuit, le ciel était nuageux et la pièce était seulement éclairée par le feu qui brillait dans l'âtre de la cheminée. Toutes ces années de solitude, sans jamais rencontrer d'hommes les avaient rendues sauvages et elles n'osaient pas parler. L'Anglais, lui aussi, gardait le silence et il fallut attendre de longs instants avant d'entendre un mot. Maria s'enhardit et lui demanda s'il était satisfait de son installation au village. Il répondit qu'il n'avait guère eu le temps de se poser la question car ses recherches l'avaient beaucoup occupé. Marthe piquée par la curiosité osa la question que tous avaient sur les lèvres:
* Qu'est-ce que vous cherchez ici? à part les écrevisses ou les lièvres, on n'a jamais rien trouvé d'extraordinaire. On est comme nos bêtes, on vit, on mange, on gratte la terre puis on nous y ensevelit un jour, dit-elle en riant.
Il leur expliqua qu'il n'était pas Anglais mais Ecossais, qu'il s'appelait Walter Bryan, qu'il avait fait des études de littérature comparée à l'Université d'Edimbourg où il avait obtenu une bourse pour étudier la vie de Byron. Est-ce en raison de l'accent avec lequel le nom du poète fut prononcé mais les deux sœurs comprirent la même chose, elles crurent que l'Anglais était venu dans cette région du Massif Central pour découvrir les burons, ces petites fromageries où l'on reçoit le lait et où l'on prépare les tomes, les peraïls avant de les livrer aux affineurs qui en font du bleu des causses ou du roquefort. Erreur qu'on leur pardonnera d'autant plus volontiers que les ancêtres de Byron venus de Normandie avec Guillaume le Conquérant portaient bien le nom de Buron et ce n'est que beaucoup plus tard que le Y fit son apparition. Elles venaient de lire un article dans un journal où l'on racontait que des étrangers, sous prétexte de tourisme, copiaient les recettes de fabrication des fromages pour en produire chez eux de semblables, sous un autre nom. Elles se lancèrent dans des explications fort longues sur la qualité du lait de leurs chèvres et de leurs brebis et proposèrent à notre Ecossais de déguster les petits péraïls qu'elles vendaient sur le marché.
Notre homme qui comprit qu'il y avait méprise mais qui ne voulait pas la dissiper abonda dans leur sens et se mit à parler de fromage, d'élevage et de moutons.
Le bruit se répandit très vite que l'Anglais, puisque c'est ainsi que l'on continuait à l'appeler, était venu dans l'Aveyron pour étudier les fromages et l'instituteur qui se piquait d'érudition déclara doctement qu'il devait s'intéresser à la caséation, un phénomène bien connu des cantalès, les maîtres fromagers parce qu'il joue un rôle essentiel dans la lente transformation du lait en cette matière compacte au goût savoureux qui fait la réputation des fromages de la région. Les explications de l'instituteur laissèrent pantois son auditoire qui, désormais, conçut pour le nouvel habitant un sentiment mêlé d'admiration et de crainte. On ne l'appela bientôt plus l'Anglais mais le Professeur et lorsqu'on le rencontrait on lui demandait si les longues heures passées dans les burons ne le fatiguaient pas trop ou s'il n'attrapait pas de rhumatismes à cause de l'humidité qui régnait dans les fleurines de Roquefort. Le malentendu aurait pu durer très longtemps si la fille du père Romiguière n'avait habité Lapeyre, un petit village près de Belmont-sur-Rance. Elle faisait le ménage à l'école communale et au foyer rural. Pour les fêtes de la Toussaint, elle était venue rendre visite à ses parents et elle eut la surprise de rencontrer notre Ecossais. Elle s'empressa de le dire à ses parents et leur apprit que depuis plus d'un mois, elle le voyait régulièrement, qu'il cherchait des documents sur une certaine Medora Taillefer, enterrée au cimetière de Lapeyre et qui aurait été la fille d'un grand poète anglais.
Notre pseudo-spécialiste en fromage était en réalité étudiant en littérature anglaise et, dans le cadre d'un diplôme universitaire, un de ces professeurs lui avait demandé d'entreprendre des recherches sur les relations sulfureuses que Lord Byron entretint toute sa vie avec sa demi-sœur Augusta. Après son mariage avec le colonel George Leigh, Augusta avait eu une fille, Medora et certains supputaient qu'elle eût pu être la propre fille de Lord Byron.
Medora avait été chassée de sa famille à l'âge de dix-neuf ans pour s'être laissée séduire par un aristocrate anglais. Son amant l'avait enlevée et emmenée en Bretagne où il l'avait abandonnée peu après, à la naissance d'une fille. La jeune mère sans ressources s'était engagée comme domestique dans des fermes, avait ramassé des pommes de terres, biné les betteraves, soigné les bêtes...C'est alors qu'elle avait rencontré un certain Jean-Louis Taillefer, paysan dans l'Aveyron. L'histoire s'arrêtait là et il était difficile de faire la part de la légende et de la réalité historique. Notre étudiant avait donc sollicité une bourse d'étude de deux ans pour poursuivre ses investigations en France. On lui avait accordé cette aide sans trop de difficulté et il était très heureux d'avoir pu en bénéficier car, s'il avait étudié le français, il n'avait jamais eu l'occasion de séjourner dans notre pays.
Pour entreprendre ses recherches, son professeur lui avait vivement conseillé de se rendre au département de littérature de la Sorbonne. Il avait dans sa poche des lettres de recommandation pour deux professeurs de littérature comparée : Charles Dedeyan et René Etiemble. Nous étions en octobre 1967 et l'année universitaire allait commencer. Lorsqu'il se présenta à la Sorbonne, au secrétariat chargé des admissions, une personne fort peu aimable lui fit remarquer qu'il venait bien tard, que les inscriptions étaient closes et qu'il ne poursuivrait aucune recherche s'il ne s'inscrivait d'abord à l'université. Il dut produire ses diplômes anglais, obtenir des équivalences pour être admis définitivement et encore lui fit-on sentir que l'Université faisait une exception en l'acceptant dans les rangs des étudiants français.
Comme il avait fait allusion aux lettres de recommandation destinées aux deux professeurs français, il fut affecté d'office au département de littérature comparée.
Il rencontra tout d'abord Etiemble, Dedeyan se trouvant à l'étranger. Il fut reçu par celui qui allait publier chez Gallimard le dernier tome du Mythe de Rimbaud. L'arrivée de ce jeune écossais, son thème de recherche ne semblèrent pas l'émouvoir. Il dépouillait un courrier fort abondant apporté par un appariteur et notre étudiant britannique ne perçut d'abord que le sommet de son crâne aussi lisse que celui de Yull Brunner dans Tarass Boulba mais auréolé de cheveux blancs comme celui de Léo Ferré. Il se lança dans un long monologue où il fut surtout question de culture chinoise et japonaise et cita de mémoire cette phrase où Goethe déclare : "Lord Byron n'est grand que lorsqu'il chante; dès qu'il veut réfléchir, c'est un enfant. Ses qualités dérivent pour une bonne part de l'homme; ses défauts, du fait qu'il est anglais et pair d'Angleterre." Tout au plus concéda-t-il que le personnage de Byron n'était pas dénué d'intérêt car, comme ce fut le cas pour Rimbaud, son œuvre était moins connue que le mythe que son existence tumultueuse avait engendré et qu'à ce titre il eût été judicieux d'en étudier la diffusion en Europe. Il conclut l'entretien en affirmant que la mort des deux poètes avait été lamentable car si Rimbaud avait succombé à une synovite cancéreuse à Marseille après avoir vécu du trafic d'armes en Ethiopie, Byron était mort d'une banale méningite à Missolonghi alors qu'il était venu combattre les Turcs. En un mot, effectuer des recherches sur la vie privée de Byron, sur ses relations avec Augusta ne lui paraissait pas plus digne d'intérêt que d'écrire dans la revue Nous Deux ou dans France Dimanche! Avec malice, il insinua que le sujet devrait bien plus passionner son collègue Dedeyan qui achevait son cycle d'étude sur le cosmopolitisme de Charles Du Bos. Cet écrivain décédé en 1933 ami de Gide, de Maritain et de François Mauriac n'avait-il pas justement consacré un livre à Lord Byron?
Notre étudiant sortit dépité et vaguement ébranlé par les déclarations péremptoires de cet éminent universitaire. Même s'il ne partageait pas tous ses propos sur Byron, il reconnaissait que le sujet que lui avait confié son professeur d'Edimbourg manquait singulièrement d'intérêt littéraire mais qu'il trouverait sa juste place dans la biographie consacrée à l'écrivain que son professeur, spécialiste de littérature anglaise, préparait en secret. Il n'était pas dupe et il savait que c'était une pratique courante que d'utiliser les étudiants comme les nègres dont font usage certains romanciers, chanteurs ou hommes politiques célèbres, à la seule différence que les nègres universitaires ne sont payés qu'avec leurs diplômes!
Quelques jours plus tard il se retrouvait dans le même couloir, au premier étage de la Sorbonne et il fut reçu, cette fois, par Dedeyan dans la bibliothèque de littérature comparée, un nom bien pompeux pour désigner une petite salle envahie de livres. Le professeur de littérature comparée l'écouta attentivement et parut intéressé par le sujet. Il lui posa quelques questions sur Byron comme s'il voulait s'assurer des connaissances de notre étudiant et l'engagea à venir l'écouter chaque mardi dans l'amphithéâtre Descartes. Il consacrerait quelques cours précisément à l'ouvrage que Charles Dubos avait publié en 1929 sur Lord Byron et le besoin de la fatalité.
Il suivit les cours de Dedeyan assidûment, sans apprendre grand chose. Il avait pourtant lu attentivement l'œuvre de Charles Du Bos mais celle-ci s'apparentait davantage à une réflexion introspective qu'à une étude littéraire, elle essayait de mieux pénétrer les rapports étranges que Byron entretint toute sa vie avec la mort. Les étudiants assistaient nombreux à ce cours magistral mais il avait remarqué que des personnes qui ne pouvaient être étudiants en raison de leur âge écoutaient religieusement le professeur; une vieille dame, en particulier, en manteau d'astrakan, chapeau noir sur la tête ne manquait aucune réunion et il avait observé que Dedeyan la saluait toujours, respectueusement, lorsqu'elle pénétrait dans l'amphithéâtre. Il apprit beaucoup plus tard qu'elle était la veuve de Charles Du Bos. En fait, il eut le sentiment que Dedeyan s'intéressait plus, à travers Byron, à la personnalité complexe de celui qui fut l'un des fondateurs de la NRF et un des animateurs du cénacle de Pontigny, cette abbaye bourguignonne où se retrouvait l'intelligentsia française de l'entre-deux guerres...De ce point de vue, il ne regrettait pas d'être là et avait le sentiment d'apprendre beaucoup sur les lettres françaises. En revanche, ses recherches sur Byron ne progressaient guère, il avait beau faire des séjours prolongés dans les bibliothèques Sainte-Geneviève ou de la Sorbonne, il ne trouvait rien d'intéressant sinon des ouvrages d'écrivains anglais qui se contentaient de répéter ce qu'il savait déjà.
Il commençait à perdre espoir jusqu'au jour où une bibliothécaire lui conseilla de se rendre aux Archives Nationales. C'est en compulsant le fichier de ces Archives dont l'entrée se trouvait alors rue des Francs-Bourgeois qu'il découvrit enfin des documents qui orientèrent ses recherches vers le petit village de Lapeyre. Dans un carton référencé RDZ 129, il tomba sur les annales de la commune rédigées au cours des années 1840-1850. On y racontait que le village avait été dévasté par une épidémie de variole transmise probablement par un colporteur qui venait de Marseille et qu'une habitante du village, Medora Leigh qui se prétendait la fille de Byron fut victime de cette redoutable maladie, on y évoquait aussi son enterrement et l'on disait qu'une certaine Georgiana Trevanion avait assisté à ses obsèques, or il savait que cette Georgiana était la propre sœur d'Augusta. Il eut accès aux archives notariales qui faisaient allusion à un testament remis à un notaire de Saint-Affrique et versé depuis lors aux Archives de Rodez. Il apprit ainsi que Jean-Louis Taillefer avant d'épouser Medora Leigh avait servi comme ordonnance chez un certain colonel de Grammont.
En consultant un annuaire téléphonique il découvrit qu'une famille de Grammont vivait encore à Paris. Il prit aussitôt rendez-vous avec une descendante de cette famille. C'était l'arrière-petite-fille du Colonel. Elle le reçut fort aimablement et lui confirma qu'elle avait entendu parler par son grand-père de la vie tumultueuse d'Elizabeth Medora Leigh. Medora avait onze ans lorsque sa mère Augusta, demi-sœur de Lord Byron, maria sa propre sœur à un cousin éloigné, Henry Trevanion. A l'âge de 16 ans, Medora partit vivre avec le couple; violée par son oncle, elle sera emmenée par les Trevanion à Calais où elle donnera le jour à un garçon.
Sa vie dès lors sera un enfer, digne des romans de Dickens. Enlevée de force par son séducteur, elle tombe à nouveau enceinte et avorte. Pour éviter le scandale, elle sera même internée plusieurs mois dans une maison de fous. Elle s'en échappe, retrouve Henry Trevanion qui l'emmène en Bretagne, lui fait de nouveau un enfant, une fille cette fois et l'abandonne, sans vergogne, dans la région de Brest où elle doit pour survivre travailler dans les champs. Quelques temps plus tard, elle est engagée par le Colonel de Grammont parce qu'il est de bon ton alors, dans une famille bourgeoise d'avoir une gouvernante anglaise. Elle y fait la connaissance d'un aveyronnais Jean-Louis Taillefer, ordonnance du colonel. Ce brave homme tombe amoureux de la jeune anglaise, lui propose de l'épouser, quitte l'armée et s'en retourne avec elle et sa fille dans son village de l'Aveyron. L'arrière-petite-fille du Colonel de Grammont ne se souvenait que de cela mais ignorait tout des relations de Byron avec sa sœur Augusta et n'avait jamais entendu dire que Medora eût pu être la propre fille du poète anglais. Elle écouta avec intérêt les révélations que notre étudiant lui fit sur la passion amoureuse que Byron entretint toute sa vie avec sa sœur Augusta. Elle savait seulement que son arrière-grand-père avait entendu parler d'une pochette en cuir dans laquelle Medora dissimulait des lettres et des poèmes de Byron et dont elle ne se séparait jamais. Cela n'avait pas surpris le Colonel de Grammont car le poète anglais était célèbre dans toute l'Europe, surtout depuis sa disparition légendaire en Grèce et il pensait qu'un jour elle vendrait, à bon prix, ces documents à un collectionneur fortuné.
Il ne lui restait plus maintenant qu'à se rendre sur place, tenter de trouver des descendants qui auraient pu conserver les précieux papiers.
Nous étions à la fin du mois d'avril et l'année universitaire touchait à son terme. Des événements imprévisibles écourtèrent ce dernier trimestre. Walter avait observé que, depuis quelques semaines, l'Université était agitée de soubresauts, aucun cours ne commençait sans que des militants de l'UNEF ou du SNES-SUP ne dénoncent l'inadaptation de l'Université ou les mesures iniques prises par le ministre de l'éducation nationale. Le 22 mars un groupe d'étudiants de Nanterre avec à sa tête un certain Cohn-Bendit remettait en cause la société bourgeoise de l'époque et appelait, ni plus ni moins, à la révolution. Des manifestations se multipliaient au quartier latin, plus violentes chaque jour. Le Vendredi 10 mai il eut quelques difficultés à rentrer chez lui, un cordon de CRS barrant l'entrée de la rue Gay Lussac. Des étudiants édifiaient des barricades, une voiture fut renversée et tout dégénéra très vite. Une première charge de policiers fut repoussée à coup de pavés et ceux-ci répliquèrent immédiatement par un tir nourri de grenades lacrymogènes. Les affrontements durèrent toute la nuit, il y eut des blessés, de nombreuses arrestations et le lendemain règnait au quartier latin un climat de guerre civile. De sa fenêtre, Walter examinait la situation avec étonnement car il ne comprenait pas très bien les raisons de cette émeute. Bien sûr, il avait constaté comme tout le monde que les amphithéâtres de la Sorbonne étaient bondés d'étudiants, que les professeurs se contentaient de cours ex cathedra sans chercher le moins du monde à communiquer avec leurs étudiants mais tout compte fait, les cours ne lui paraissaient ni meilleurs ni pires que ceux des professeurs anglais ou écossais. En outre, la France paraissait bien plus prospère que l'Angleterre, la plupart des français disposaient d'un téléviseur, d'une machine à laver et surtout d'une voiture. Il avait le sentiment que nos compatriotes s'opposaient surtout au pouvoir de plus en plus personnel d'un de Gaulle vieillissant qui entamait son second septennat et qui ne semblait plus comprendre les aspirations de ses compatriotes. Le lundi 13 mai eut lieu une grande manifestation où des milliers de parisiens défilèrent de la République jusqu'au quartier latin en chantant l'Internationale et en exigeant la réouverture des universités ainsi que la libération immédiate des étudiants arrêtés lors des affrontements de la rue Gay-Lussac. Le mardi 14 mai la Sorbonne était réouverte et sur le champ réoccupée par ceux qui en avaient été chassés la veille. Walter pensait que les cours allaient bientôt reprendre puisque les étudiants avaient obtenu satisfaction mais, au lieu de cela, il constata que tous les amphithéâtres regorgeaient de jeunes gens qui s'y exprimaient avec plus de véhémence que les tribuns du Tiers Etat dans la Salle du Jeu de Paume en 1789. En traversant la cour d'honneur de la Sorbonne, il assista à un spectacle peu commun. Des étudiants venaient de hisser sur le perron de la chapelle un piano à queue, probablement celui qui dormait depuis des années dans le grand amphithéâtre et un barbu, aux cheveux noués en catogan interprétait, tour à tour, des Polonaises de Chopin ou de la musique de Duke Ellington sous le regard admiratif des badauds. Impression étrange d'un monde qui semblait tituber. Les jours suivants confortèrent cette impression, les ouvriers, les employés rejoignirent les étudiants et leurs professeurs. Des milliers d'hommes et de femmes se retrouvèrent dehors, sous le soleil resplendissant de ce mois de mai et tous entrèrent dans une sorte de délire collectif où chacun eut quelque chose à dire. Tandis que l'ivresse s'emparait de la foule, le pouvoir se réfugiait dans ses palais et pendant près de trois semaines, la République vacilla sous les coups de butoirs d'une France devenue folle. "Il fut interdit d'interdire, le pouvoir était désormais dans la rue et la plage sous les pavés", autant de slogans qui fleurissaient sur des affiches éditées à la hâte, rue Bonaparte par des étudiants des Beaux-Arts et que des jeunes gens collaient frénétiquement sur les murs de la capitale, personne ne voulait plus du pouvoir traditionnel, ni de la droite ni de la gauche. La radio fit état du départ du Général de Gaulle, personne ne savait ce qu'il était devenu. Mitterand hué quelques jours plus tôt par des étudiants alors qu'il se promenait Boulevard Saint-Germain n'hésita pas à parler de vacance du pouvoir et la politique ayant comme la nature horreur du vide, il était prêt à assumer toutes les responsabilités si le peuple le lui demandait. Il n'eut pas à attendre la réponse du peuple car le soir même le général de Gaulle de retour de Baden-Baden appelait les français à un sursaut national, annonçait des réformes et de nouvelles élections. Le lendemain eut lieu la manifestation des Champs-Elysées où les partisans de de Gaulle côtoyaient parfois d'anciens manifestants du 13 mai, dans une sorte de célébration eucharistique où le chef de l'état honni quelques jours plus tôt redevint le symbole du rassemblement et fut l'objet de tous les encensements. Malraux qui se prenait pour Danton ou mieux encore pour la Marseillaise de Rude vociférait des discours incompréhensibles aux côtés de Michel Debré qui roulait des yeux de carmagnol. Tableau surréaliste qui amusa fort notre jeune anglais mais la plaisanterie devenait chaque jour plus insupportable, plus de courrier, pas de transports, il ne pouvait même plus changer ses livres sterlings dans des banques qui avaient toutes fermé leurs guichets. Les bibliothèques n'ouvraient plus leurs portes et il se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre ses recherches sur Byron. La Sorbonne était aux mains des Katangais qui jetaient consciencieusement les dossiers administratifs par les fenêtres donnant rue Saint-Jacques.
Le mal du pays le prit et il voulut entrer en contact avec des compatriotes qui étudiaient aussi à Paris; il savait que certains avaient l'habitude de se retrouver au Saint-André-des-Arts, Place Saint-Michel. Il s'y rendit et eut la surprise de revoir un de ses amis d'Edimbourg qui avait traversé la Manche avec lui et dont il était sans nouvelles, un certain John Whilmer; ce dernier était le fils d'une grande famille londonienne, son père était banquier à la City et sa famille lui avait offert le jour de ses vingt ans un voyage en Europe comme cela était de tradition dans les familles aristocratiques anglaises; après avoir visité l'Allemagne, l'Italie et la Grèce, il s'était établi en France, au quartier latin et menait une vie dispendieuse, consacrée essentiellement aux boîtes de nuit, à l'alcool et aux femmes. Il passait le plus clair de son temps dans les lieux à la mode, circulant dans les rues de la capitale au volant d'une superbe jaguar bleu nuit. Il était accompagné de deux ravissantes créatures, une blonde qui semblait être sa petite amie du moment et une brune, une eurasienne, au prénom de roman-photos, Priscillia. C'était une fille très belle, aux cheveux longs couleur de jais encadrant l'ovale d'un visage de madonne florentine et qui vous fascinait par l'éclat étrange de ses yeux mordorés. Il apprit, plus tard, qu'elle était la maîtresse d'un industriel de S... Libre le week-end car l'homme était marié, elle venait à Paris dépenser l'argent que lui donnait son amant et profitait de son séjour dans la capitale pour s'amuser.
Retenue à Paris par les grèves de la SNCF, elle avait rencontré John Whilmer au Golf Drouot. Elle logeait dans un petit hôtel du quartier latin. Notre Ecossais tomba tout de suite amoureux de la belle Priscillia et c'est dans sa chambre que notre spécialiste de Lord Byron, encore tout étourdi par l'aventure se retrouva, le soir même, expérimentant avec délice les sensations troubles éprouvées à la lecture des lettres enflammées du poète anglais à Augusta. Walter n'avait connu que peu d'aventures amoureuses avant de venir à Paris, juste des amours de vacances avec la fille d'amis de ses parents et quelques rencontres fugaces avec des prostituées de la rue Saint-Denis; la découverte du plaisir charnel fut donc complète et ils restèrent près de trois jours dans la chambre d'hôtel sans sortir, se faisant porter le petit déjeuner et les repas et vivaient heureux, dans une sorte d'orgasme permanent.
En allumant la radio le 30 mai, ils apprirent que les grèves s'achevaient et que la circulation des trains allait reprendre. Priscillia devait repartir à S... mais elle lui dit qu'elle viendrait une semaine plus tard et qu'ils se reverraient à l'hôtel. Il la raccompagna à la gare du Nord et ils firent une dernière fois l'amour dans les toilettes du sous-sol. Voir un couple sortir de cet endroit eût surpris quelques mois plus tôt les passants mais en cette fin de mois de mai 1968 où tant de choses bizarres s'étaient produites et où l'on avait rejeté tout interdit, personne n'eût songé à protester ou même ne se fût étonné.
La semaine lui parut interminable et le samedi soir, Walter se précipita à la réception de l'hôtel. Quelques minutes plus tard, il pénétrait dans la chambre 8, au 1er étage et avec non moins d'ardeur les deux amants se livrèrent à un corps à corps frénétique qui dura tout un week-end. C'est le dimanche soir que Priscillia fit quelques confidences sur ses séjours à Paris. Elle se prénommait en réalité Janine et elle lui raconta qu'elle était arrivée à Paris en 1954, après la chute de Diên Piên Phu. Son père, sous-officier à la Légion Etrangère avait épousé sa mère à Hanoï, ils avaient eu cinq enfants et s'étaient retrouvés dans la capitale dans un minuscule appartement de la rue Vaugirard. Son père avait quitté l'armée et trouvé un emploi de vigile dans une entreprise d'import-export mais il y eut rapidement de la mésentente dans le couple, des disputes incessantes, le père se mit en ménage avec une autre femme et disparut un beau jour. Un oncle indochinois qui tenait un restaurant à S...invita la famille à venir les rejoindre. La mère et les sœurs aînées servirent quasi bénévolement au restaurant mais elles eurent droit au gite et au couvert. Priscillia avait un frère un peu plus jeune qu'elle, seul garçon de la famille, il avait toujours été choyé par ses sœurs. A l'adolescence, il fit de mauvaises rencontres. Impliqué dans des vols de voitures puis dans une attaque à main armée, il fut emprisonné plusieurs mois. Après tout alla de mal en pis, il goûta à la drogue, d'abord au hashish puis bientôt à l'héroïne et progressivement sombra dans une sorte d'indifférence au monde, n'ayant d'autre préoccupation que la dose de drogue dont il avait besoin pour survivre. Sa famille l'avait rejeté et il vivait avec sa sœur Priscillia qui continuait à prendre soin de lui.
Dès l'âge de 22 ans, elle avait été la maîtresse de notables de la ville et le dernier en titre était l'industriel. Celui-ci lui donnait de l'argent et elle pouvait acheter de la drogue. Malheureusement, les besoins en héroïne de son frère ne cessaient de croître et elle dut venir de plus en plus souvent à Paris se réapprovisionner. L'argent donné par l'industriel ne suffisait plus. Elle profita bien souvent de la générosité de touristes fortunés en quête d'érotisme et qui, moyennant finance, profitèrent de ses charmes. Priscillia était très belle et trouvait facilement de généreux donateurs. Walter ne s'indigna nullement de ses confidences car il considérait Priscillia comme victime d'une situation dont elle n'était pas responsable et il trouvait admirable qu'elle acceptât encore de prendre en charge son frère mais est-il nécessaire d'ajouter qu'il était surtout follement amoureux d'elle.
Arrivés à l'angle du Boulevard de Strasbourg et de la rue de Magenta, elle demanda à Walter de l'attendre quelques instants, elle pénétra dans un immeuble désaffecté où vivaient des marginaux et ne revint qu'un peu plus tard avec ce qu'il fallait d'héroïne pour calmer la souffrance de son frère.
Les mois de juin et de juillet furent pour eux des moins enivrants où ils connurent un bonheur et un plaisir intenses mais leurs amours durent prendre fin car Walter avait reçu une lettre de ses parents où ceux-ci lui demandaient de revenir en Ecosse. Il n'était retourné qu'une fois chez eux à l'occasion des fêtes de Noël, sa mère était tombée gravement malade et les médecins envisageaient de l'hospitaliser pour une intervention chirurgicale. Nos amoureux se quittèrent à regret promettant de se revoir bientôt.
Walter resta à peu près tout le mois d'août en Ecosse et ne revint à Paris que le 5 septembre. Il était inquiet car il avait écrit régulièrement à Priscillia mais n'avait jamais reçu de réponse. Il avait essayé de la joindre à l'hôtel mais on lui avait dit que personne ne l'avait revue depuis qu'ils s'étaient quittés. Dès son retour, en septembre, il pensait la revoir mais il n'obtint aucune nouvelle ni par l'hôtel ni par son ami John.
Les jours qui suivirent il n'eut pas le courage de se remettre au travail, ses recherches sur Byron à présent l'ennuyaient et il errait toute la journée dans les bibliothèques du quartier latin, feuilletant les ouvrages mais n'ayant pas le cœur à les lire. Le 8 septembre alors qu'il venait de rentrer chez lui, on frappa à sa porte. Un jeune homme livide, au regard halluciné se présenta de la part de Priscillia et lui apprit que son frère était mort d'une overdose. Comme il y avait eu d'autres morts suspectes à S..., il craignait qu'elle ne fût arrêtée par la police pour trafic de stupéfiant. Il lui avoua que c'était lui qui lui fournissait de l'héroïne lorsqu'elle venait à Paris, il lui montra une petite enveloppe qui contenait la fameuse poudre blanche. Il le supplia de la garder, Priscillia lui avait achetée d'avance et elle l'avait prévenu que si elle ne venait pas boulevard Magenta, il devrait apporter le sachet à son ami anglais et, avec l'histoire du frère, il s'attendait à voir débarquer chez lui la brigade des stups. Walter pensait que c'était peut-être le seul moyen de revoir Priscillia et il accepta sans hésiter le sachet qu'il rangea dans une boîte contenant du thé. Le lendemain il se rendait à S... Il ne disposait que d'une seule indication griffonnée sur un bout de papier : rue de l'Evéché. Il erra dans la ville et découvrit l'adresse grâce à un facteur qui distribuait le courrier. L'appartement se trouvait au dernier étage d'un immeuble vétuste, il gravit quatre à quatre les marches de l'escalier persuadé qu'il allait la retrouver là-haut. Hélas, il ne vit qu'une carte punaisée sur la porte, il fallait s'adresser au généreux mécène. Il n'eut pas de difficulté à trouver sa maison. Il habitait une superbe propriété dans une rue assez proche d'une étrange église dont il ne subsistait que les deux tours gothiques. Il sonna, demanda à rencontrer l'homme. Celui-ci le reçut froidement, le soupçonnant probablement d'être un des pourvoyeurs de drogue. Walter lui expliqua qu'il ignorait tout à ce sujet si ce n'est qu'un dealer était venu lui apporter une enveloppe contenant de l'héroïne. L'industriel lui dit que Priscillia avait été emprisonnée à la suite du décès de son frère parce qu'on la soupçonnnait de le ravitailler en héroïne ainsi que d'autres drogués de la ville. Lui-même avait été convoqué par la police et il avait dû prendre un avocat pour se défendre. Il fut vite mis hors de cause mais l'affaire fit grand bruit à S...où tous les notables se fréquentaient au Lion's club. Son aventure avec la nièce du restaurateur chinois défraya la chronique. Il fit jurer à Walter de ne plus chercher à la revoir parce que la police ne manquerait pas de remonter jusqu'aux trafiquants chez qui elle achetait la drogue. Il pensait que Walter pouvait être inquiété et qu'il avait intérêt à se faire oublier, du moins pendant un certain temps. Quant au sachet d'héroïne, il conseilla vivement à notre jeune Ecossais de s'en débarrasser le plus vite possible. Walter le supplia pour qu'il transmît une lettre qu'il avait écrite à son intention. Le cœur brisé, il repartit à Paris et décida de quitter son appartement et de poursuivre ses investigations sur Byron dans l'Aveyron. Il demanda à la concierge de lui adresser son courrier poste restante à Rodez où il pensait ne rester que quelques jours...
En fait, aux Archives Départementales, il ne trouva pas grand chose si ce n'est des actes de décès ou des dispositions testamentaires où figuraient les noms des personnes présentes à la mort de Medora ainsi que le nom de ses héritiers. Il apparaissait que tout ce qu'il cherchait devait se trouver à la mairie de Lapeyre et qu'il n'y avait d'autre issue que de se rendre sur place. L'archiviste de Rodez connaissait quelqu'un qui, justement, louait une petite maison à proximité du village de Medora. Comme l'endroit était isolé et qu'il n'y avait guère de confort, juste un lit, un vieux buffet, quatre chaises et de la vaisselle ébréchée, cela ne lui coûterait pas trop cher.
Quelques jours plus tard, il montait dans un vieux car Citroën qui le conduisit à travers le plateau du Lévézou, jusqu'à Saint-Rome-de-Tarn où il dut se résoudre à acheter un vélo pour gravir la route qui monte en lacets jusqu'au village. C'est ainsi qu'il débarqua dans la vieille ferme occupée naguère par Louise Puech. Il écrivit rue Gay-Lussac à la concierge pour lui communiquer sa nouvelle adresse, espérant toujours recevoir des nouvelles de Priscillia.
Ses recherches sur Byron progressaient bien, il avait même réussi à trouver des personnes qui lui affirmaient que des documents importants, ces fameuse lettres dont Medora ne se séparait jamais, avaient dû être remises au prêtre qui lui avait administré l'extrême-onction quand on la sut perdue. Dans les années 1890-1900, ce dernier avait pris sa retraite à Saint-Jean d'Alcapies chez des parents éloignés qui tenaient une auberge.
En se rendant dans ce lieu sauvage qui se trouve aux confins du Larzac, il apprit que l'auberge avait disparu depuis longtemps et que l'aubergiste et sa femme étaient morts. Leur fille avait dû se marier et quitter le village mais personne ne savait sous quel nom elle vivait. On se souvenait seulement de son prénom : Anna.
Malgré tous ses efforts, notre Ecossais ne parvenait pas à retrouver la mystérieuse Anna, il semblait que lorsqu'il était près d'aboutir, de nouvelles difficultés surgissaient. Anna était introuvable.
Il ne fallut pas moins d'un heureux concours de circonstances pour qu'il pût, enfin, retrouver la trace des mystérieux documents. Un jour où Walter venait une fois de plus effectuer des démarches infructueuses dans une mairie, il eut la curiosité de pénétrer dans une petite brocante installée sur la place du village, un de ces magasins où l'on trouve de tout, des grilles à faire cuire les châtaignes, des armoires en chêne noirci ou de vieux chromos sur l'Exposition Universelle de 1900. Le marchand qui somnolait dans un fauteuil à bascule ignorait sa présence et il put sans scrupule toucher à tout quand, soudain, son attention fut attirée par des poèmes de Shelley dans une édition d'époque; il découvrit à sa grande surprise La reine Mab et l'ode au vent d'ouest. Alors qu'il feuilletait ce dernier ouvrage, un papier consciencieusement plié en quatre s'échappa du volume. Walter, discrètement, mit le document dans sa poche et demanda le prix de l'ouvrage : "15 balles" lui répondit en maugréant le brocanteur brutalement sorti de son sommeil. Walter donna la somme demandée sans discuter car il lui avait semblé reconnaître sur le papier une écriture qui lui était presque aussi familière que celle de ses parents ou de ses amis les plus chers. A n'en pas douter, les phrases qui y figuraient étaient bien de la main de Lord Byron. Comme s'il avait craint que le brocanteur ne revînt sur son prix, Walter monta sur son vélo précipitamment et on le vit gravir les côtes plus vite que Bahamontes, un champion cycliste espagnol qui avait remporté des victoires de montagne cette année-là.
Dès qu'il fut arrivé chez lui, il s'assit devant la petite table où il avait pris l'habitude de travailler et déplia avec précaution le document. Au recto figurait un poème adressé à Augusta, écrit de Missolonghi et daté d'avril 1824. Il connaissait par cœur le poème consigné dans le Journal de l'écrivain et qui commençait par ces deux strophes célèbres :
"Ce cœur devrait cesser d'aimer lui-même,
Voyant pour lui les autres se fermer,
Mais s'il n'est plus possible que l'on m'aime,
Ah! qu'on me laisse aimer!
L'automne vient pour moi, la fin du songe
Où l'amour perd son fruit après sa fleur;
Je n'ai plus rien que le ver qui me ronge,
Plus rien que le malheur!"
Au verso, figurait un poème inconnu et dédié à Augusta
"Sais-tu que je t'ai revue
Une dernière fois
Sur une plage blanche et bleue
Bordée de palmiers et d'asphodèles,
Rivage mortel des mers vireuses
Aux floraisons fragiles de cytises et de tamariniers.
Dans tes yeux d'agate vairée
Aux transparence de Marmara,
Luisait l'appel du Bosphore.
Sais-tu que je t'ai revue
Face au grand jardin de pierres,
Toi, ma sœur, ma tendre sœur,
Dans une chambre blanche et bleue.
Comme la mémoire a d'étranges détours
Dans le golfe de Saros!"
Walter en feuilletant le volume de Shelley s'aperçut que la page de garde comportait aussi une annotation de Byron et s'adressait directement à "sa fille bien aimée : Medora". Cette découverte était capitale puisqu'elle mettait un point final à deux années de recherche. La preuve était faite que, non seulement, Medora était bien la fille de Lord Byron mais qu'au dernier moment de sa vie, alors qu'il se savait perdu, une de ses dernières pensées fut bien pour Augusta. Il ressentit alors l'ivresse et la volupté que doit éprouver tout chercheur lorsqu'enfin, après tant de déboires et d'insuccès, il trouve la clef de l'énigme. Il ne lui restait plus maintenant qu'à regrouper les fils du récit et à rédiger le mémoire qu'il devrait soutenir à Edimbourg. Il consacra de nombreuses heures à écrire, ne sortant plus de chez lui, oubliant presque Priscillia. Marthe venait, comme elle avait eu l'habitude de le faire au temps de Louise Puech, lui porter une bonne soupe aux poireaux et aux pommes de terre. Elle était éblouie par ce jeune homme qui passait de longues heures à écrire sur des feuillets tant de choses qu'elle ne comprenait pas, parfois, elle se risquait à poser quelques questions sur ce Byron qu'elle avait pris, naguère, pour une cave à fromage et qui semblait tant accaparer notre jeune homme et lui, prenait plaisir à lui parler de cet écrivain qu'il aimait et auquel il avait consacré tant d'heures. Il lui arrivait de lui lire des strophes du Chevalier Harold en anglais puis traduisait pour qu'elle pût comprendre. Marthe qui n'avait pas étudié au-delà du certificat d'études était fascinée par les vers du poète qu'ils fussent déclamés en français ou en anglais et elle apprenait par cœur des pages entières qu'elle récitait à sa sœur qui se demandait si elle ne devenait pas folle!
Walter avait presque fini son ouvrage quand il reçut une lettre de l'industriel de S.... Cette lettre avait mis beaucoup de temps à lui parvenir, réexpédiée à Rodez puis ici, elle avait dû être écrite une quinzaine de jours plus tôt. Elle lui apprenait une terrible nouvelle. Priscillia n'avait pu être relâchée comme il l'avait espéré, le juge d'instruction l'avait maintenue en prison et elle n'avait pas supporté cette nouvelle épreuve, elle s'était pendue dans sa cellule. Walter était effondré, il en voulait au médecin de lui avoir interdit de la revoir, peut-être était-ce pour cela aussi qu'elle s'était suicidée. Le chagrin l'envahissait. Sa porte resta fermée, même Marthe ne put pas entrer. Un soir alors qu'il venait de terminer son mémoire, il décida d'utiliser le sachet d'héroïne, il descendit en vélo jusqu'à Saint-Affrique et acheta une seringue chez le pharmacien. Il prit le petit sachet dissimulé dans le paquet de thé. Bien qu'il n'eût jusqu'à présent jamais fait usage d'héroïne, comme tous les jeunes de son âge, il en connaissait parfaitement le mode d'emploi. Il fit chauffer dans une petite cuillère la poudre blanche et lorsque la mixture fut prête, il se l'injecta au creux de son bras. Une sensation étrange l'engloutit progressivement, il se revoyait dans les moments d'extase qu'il avait vécus avec Priscillia, il revoyait son amante, ses lèvres, ses caresses, la douceur de sa peau, il ressentait l'ivresse du plaisir, il entendait son cœur cogner, cogner si fort que son corps tout entier s'embrasait. Dans une sorte de paroxysme, il eut le sentiment de quitter ce monde et de s'envoler vers d'autres galaxies...
Comme les volets restaient désespérément clos, Marthe fut saisie d'inquiétude, elle demanda à Joseph le forgeron qui était un peu serrurier de forcer la porte. Ils le découvrirent sans vie, écroulé devant sa table de travail. Le médecin qui fut appelé ne put que constater le décès. L'instituteur qui connaissait un peu l'anglais écrivit à la famille et il fut enterré dans le petit cimetière où une plaque fut déposée. Il y eut un article dans le Journal de Millau et dans le Progrès de Saint-Affrique où l'on parla de la mort par overdose d'un jeune anglais et l'on ne manqua pas de faire des rapprochements avec d'autres décès qui s'étaient produits chez de jeunes hippies qui élevaient des chèvres sur le Larzac.
Marthe jusqu'à sa dernière heure garda au chevet de son lit le poème de Byron adressé à Augusta et, chaque soir, elle relisait la traduction que Walter lui avait donnée comme si ce poème lui était destiné. A la mort de sa sœur, Maria qui avait un peu perdu la tête, fut envoyée dans une maison de retraite et le précieux manuscrit fut jeté aux ordures.
Chapitre 3...