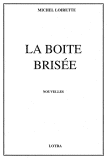LE DEJEUNER SUR L'HERBE
Ce dimanche 26 Juin, il fut décidé d'aller jusqu'à Cramassous, déjeuner sur l'herbe. L'anniversaire d'Hippolyte tombait le lendemain mais son fils, Marius, devait revenir ce jour-là à Paris pour passer un concours administratif. Eugénie eut beau protester, dire que fêter un anniversaire la veille portait malheur, rien n'y fit, les enfants se moquèrent d'elle en disant que c'était des superstitions d'un autre âge et qu'ils voulaient être au village pour les feux de la Saint-Jean. Ce qu'ils ne savaient pas en parlant de superstition, c'est que la fête aurait dû avoir lieu le vendredi soir mais comme le 24 juin, jour de la Saint-Jean était un vendredi, date maudite depuis la mort du Christ, les festivités se déroulaient le dimanche. Toute la famille se rendit à Saint-Rome par le car de Rodez qui depuis quelques années avait remplacé la vieille patache. Depuis le mariage d'Elise avec un Lyonnais et le départ de Marius pour la Faculté de droit à Paris, les occasions de se retrouver se faisaient rares. Marius avait décidé de profiter de cette journée à la campagne pour annoncer ses fiançailles avec une jeune fille qu'il avait connue à Vichy.
Eugénie et Hippolyte regrettaient que leurs deux aînés n'aient pas trouvé dans la région le jeune homme ou la jeune fille qui leur eût convenu. Comme bien d'autres aveyronnais, ils voyaient à regret leurs enfants s'expatrier dans des contrées lointaines. Même s'ils gardaient le secret espoir qu'ils revinssent un jour, ils craignaient que ces villes inhumaines n'engloutissent à jamais leurs enfants dans leurs dédales de rues et d'immeubles à étages. Ce qu' ils redoutaient peut-être le plus, c'était qu'ils renient leur famille, leurs montagnes, leurs traditions. Le départ de Marius les avait particulièrement touchés. Le jeune homme qui avait accompli des études brillantes au petit séminaire avait refusé d'embrasser la carrière sacerdotale estimant ne pas avoir la vocation. Il ne deviendrait jamais prêtre ce qui avait toujours été l'ambition affichée par ses parents. Pour tous ceux qui avaient comme eux vécu dans la région de Saint-Rome-de-Tarn demeurait vivace le souvenir de prélats exemplaires comme Monseigneur Affre, l'évêque qui mourut, en 1848, sur les barricades parce qu'il avait voulu s'interposer entre les émeutiers et la garde civile. C'était, en ce début du XXème siècle encore un grand honneur que d'avoir un prêtre dans sa famille.
En classe de rhétorique Marius avait manifesté son désir de ne pas poursuivre d'études religieuses pour faire carrière à Paris dans l'administration. Ce mot résonnait curieusement dans l'esprit des aveyronnais. C'était bien sûr la sécurité de l'emploi mais pour des gens de la province, ce nom était bien souvent synonyme de contrôles, de paperasses, d'impôts et de taxes, enfin de toutes ces tracasseries inventées par des gens qui vivaient dans des villes du Nord et dont Paris assumait, avec ses fonctionnaires des grands ministères, toute la quintessence diabolique. N'était-ce pas aussi de là-haut que des financiers anonymes et corrompus qui n'avaient que mépris pour le peuple décidaient du sort des paysans et des ouvriers? Tous ces nantis n'étaient-ils pas à l'origine du déclin de la sidérurgie et de la fermeture des forges de la Forézie et d'Aubin-le-Gua?
Marius avait dû lutter pour faire admettre sa décision. Il avait connu des moments difficiles. Engagé comme surveillant puis comme répétiteur au Lycée de Saint-Flour et au Collège de Cusset, il n'avait jamais pu suivre les cours des professeurs en raison de l'éloignement de l'Université. Il avait choisi le droit parce qu'il n'était pas indispensable d'assister aux cours. Il surveillait les élèves et étudiait en même temps le code civil et le code pénal. Son passé d'interne au Séminaire de Belmont lui avait été fort utile et il n'éprouvait aucune difficulté, contrairement à certains de ses collègues, à faire régner une discipline de fer dans les dortoirs ou les salles d'étude. Les élèves le craignaient et le respectaient car on savait que s'il exigeait le silence pour que chacun puisse travailler dans le calme, il était prêt à aider les élèves en difficulté pour traduire telle phrase de Cicéron ou de Sénèque. Il avait passé cette dernière année d'étude à Paris car seule son université délivrait un certificat de droit international et de droit des colonies, indispensable pour passer certains concours administratifs comme ceux qui permettaient d'entrer dans les ministères prestigieux des colonies ou des affaires étrangères. Il occupait une chambre mansardée au 6ème étage de la Rue Falguière et gagnait sa vie en démarchant des assurances dans les arrondissements de la capitale. Il était payé à la commission et comme la concurrence était rude, il gagnait peu et devait, bien souvent, se contenter comme nourriture d'une miche de pain et d'un bol de viandox.
Elise était venue avec sa petite Claudette qui avait juste deux ans. Son mari qui était courtier en vin l'avait accompagnée et il profitait de son séjour à Millau pour effectuer des achats en gros chez des viticulteurs de la région. Les parents habitaient rue Gambetta depuis qu'ils avaient dû quitter, à contre-cœur, la propriété du Général où ils avaient vécu plus de 20 ans.
Ce repli des gens de la campagne et des petites villes vers les cités industrielles s'était accentué après la première guerre mondiale. Au lendemain de l'armistice, il fallut bien se rendre à l'évidence mais plus rien ne serait semblable. La guerre avait fauché toute une génération d'hommes valides, beaucoup de jeunes gens n'étaient pas revenus des tranchées; la France était exsangue, les campagnes dépeuplées, toute une jeunesse décimée. Le Rouergue avait perdu plus de 15 000 hommes : des paysans, des jeunes, des célibataires en âge de fonder un foyer, enfin tous ceux qui faisaient l'âme et la vitalité de cette région. Certaines communes ne se relevèrent jamais de le perte de leurs hommes. Les campagnes, grandes pourvoyeuses de fantassins payèrent un lourd tribut à la défense du pays. Lorsqu'un voyageur traversait les villages, il ne voyait plus que des femmes, des enfants, des vieillards et des éclopés.
Hippolyte eut la chance de revenir indemne de la guerre mais il dut probablement son salut au fait qu'il ne fut pas mobilisé comme la plupart de ses compagnons dans un bataillon d'infanterie. Excellent cavalier, il avait été affecté en 1914 dans le 2ème régiment de chasseurs à cheval. Les premières charges contre les uhlans, au nord de la France eurent lieu, en dolman bleu et culotte rouge, shako à pompon rouge, sabre au clair, latte haute, dans la grande tradition des batailles napoléoniennes. Après la victoire de la Marne, l'Etat Major fit appel à des techniques plus modernes mais aussi plus meurtrières. Les canons devinrent plus puissants et plus précis, les gaz mortels proliférèrent, des grenades furent utilisées et les fantassins pour se protéger s'abritèrent dans des tranchées creusées à la hâte dans la terre boueuse et qui se révélèrent bien vite des protections dérisoires contre le déferlement de feu et de mitraille. La guerre cessa d'être une guerre de mouvement pour devenir une guerre de position. Les chevaux plus vulnérables furent remplacés par des voitures blindées à chenilles puis apparurent les premiers chars d'assaut, ancêtres de nos blindés modernes derrière lesquels les fantassins s'abritaient pendant les contre-offensives. Hippolyte qui avait commencé la guerre à cheval la finit dans un de ces engins.
De retour à Saint-Affrique, il pensait retrouver son emploi de cocher dans la famille du Général, officier de grand renom qui s'était illustré au cours de la défense de Nancy et qui aurait été promu Maréchal de France si ses idées politiques avaient été moins conservatrices. Hippolyte avait travaillé dans cette famille dès l'âge de 25 ans. Les trois enfants étaient nés dans les communs où vivaient les autres domestiques. Avant la guerre le château avait employé jusqu'à une quinzaine de personnes dont le travail était ordonné et surveillé avec beaucoup de rigueur par un majordome qui avait été, naguère, ordonnance du Général. C'était un homme sévère mais juste qui savait donner des ordres et se faire obéir. Le protocole et l'étiquette étaient scrupuleusement respectés, les valets de pied accueillaient les visiteurs en habit, des gouvernantes anglaises s'occupaient des jeunes enfants, les palefreniers brossaient énergiquement les chevaux et entretenaient les cuirs des selles et des harnachements tandis que de simples servantes assuraient le ménage. Hippolyte bénéficiait d'une situation particulière car il était le seul à ne dépendre que du Général. Il avait en charge le dressage, l'entraînement et la conduite des chevaux. Ce qui n'était pas une petite affaire. L'écurie était remarquable pour une petite ville de l'Aveyron et il eût fallu aller dans de grandes familles albigeoises ou toulousaines pour trouver des chevaux d'une telle qualité. Dans les périodes les plus fastes, l'écurie ne comportait pas moins d'une vingtaine de bêtes, des percherons gris pommelés que l'on utilisait pour les travaux des champs ou pour tirer de lourdes charges, des poneys pour les enfants, des hongres destinés aux attelages ordinaires lorsqu'il fallait aller à la foire à Millau mais le général possédait surtout des chevaux de selle, des purs sangs arabes achetés au Maroc mais aussi des purs sangs anglais de grande origine qui provenaient de la région de Saint Lô. Les chevaux n'étaient pas tous montés par leur propriétaire et Hippolyte devait les entraîner quotidiennement, soit en monte ordinaire soit à la longe dans une carrière située dans le Parc du Château. Il passait ainsi de longues heures à sauter les obstacles, à rectifier les allures, à pratiquer des exercices de haute école comme la croupade ou le trot espagnol. C'est lui aussi qui donna à la fille du Général ses premières leçons d'équitation. Il lui apprit à monter comme un homme mais aussi comme cela était de tradition dans les familles aristocratiques, en amazone.
Son plus grand bonheur était, sans conteste, d'accompagner son maître jusqu'à Albi. Hippolyte éprouvait une admiration sans borne pour le Général, personnage haut en couleur, d'une autorité sans partage et qui règnait sur sa maison comme un seigneur du Moyen Age. Il avait un goût particulier pour les courses de chevaux et lorsqu'il trouvait une portion de chemin suffisamment longue et plate -ce qui n'était pas toujours facile dans cette région montagneuse-, il demandait à Hippolyte de pousser les chevaux à la limite de leur résistance et le tilbury tracté par les deux purs sangs semblait s'envoler sous un nuage de poussière, au milieu des hurlements des malheureux bergers qui à ce moment menaient justement paître leurs troupeaux. Il aimait aussi dresser les chevaux que le Général achetait à Albi et qu'il menait à la longe jusqu'à Saint-Affrique. C'était souvent des animaux rétifs, nerveux, sensibles qu'il fallait dompter avec patience. Le dressage était périlleux et dans les premiers instants, les chevaux s'élançaient au grand galop, ruaient, bondissaient, tentaient de se débarrasser de cette charge inutile qu'était pour eux le cavalier.
Eugénie était lingère et toute la journée elle lavait, repassait, raccomodait le linge de tout le petit monde qui vivait dans la propriété. Etait-ce de vivre depuis de nombreuses années dans une maison bourgeoise mais Eugénie et Hippolyte qui étaient des enfants de paysans avaient adopté, peut-être, par mimétisme les comportements de leurs maîtres. Ainsi, étaient-ils très soucieux de leur toilette lorsqu'ils sortaient en ville et, coutume extrêmement rare à cette époque dans les milieux populaires, les enfants vouvoyaient leurs parents. La guerre marqua le terme de cette vie qui s'apparentait plus par ses côtés désuets à la vie des aristocrates des siècles passés qu'au monde moderne.
En 1919, le Général s'installa dans une propriété qu'il possédait dans le Lot et confia son château à son gendre. Sa fille venait d'épouser un riche industriel de Millau qui possédait une des plus grandes mégisseries de la ville. Contrairement au Général, c'était un piètre cavalier et sa première décision en arrivant au château fut d'acheter une superbe Torpédo et de vendre les chevaux, à l'exception d'une jument qu'il conserva pour sa femme. Autant dire que la présence de palefreniers et de cocher ne paraissait plus nécessaire et il fut décidé de mettre fin à leurs fonctions. Les pauvres bougres qui avaient toujours travaillé là furent mis à la porte sans ménagement avec leurs femmes et leurs enfants; Roger le plus jeune partit à Decazeville où il fut engagé dans la mine, les autres allèrent sur le Larzac garder les moutons. La femme du nouveau propriétaire supplia son mari pour qu'il traitât Hippolyte avec moins de rigueur. Le nouveau maître de la maison le fit entrer comme chauffeur à la ganterie Guibert de Millau pour conduire cette fois, lui dit-il en souriant, "après les vrais chevaux, des chevaux vapeur". Hippolyte n'eut d'autre choix que d'accepter et quelques jours plus tard la famille s'installait rue Gambetta.
Le changement fut brutal. Habitués à la vie de domestique dans une maison bourgeoise, ils n'étaient pas du tout préparés au travail en usine, dans une ville où ils ne connaissaient personne.
Les fabriques étaient alors en plein essor et employaient des milliers d'hommes et de femmes. L'année passée, on avait battu un record en produisant 3 300 000 paires de gants qui avaient été livrées dans le monde entier. Les peaux étaient d'abord préparées à Saint-Junien où elles étaient blanchies à l'alun puis découpées et assemblées à Millau. Les hommes étaient surtout utilisés à la coupe et à la manutention des peaux alors que les femmes travaillaient à l'assemblage. Des ouvrières cousaient dans des ateliers immenses sous le regard attentif des contrôleurs, dans le bruit infernal des machines tandis que d'autres préféraient coudre à domicile ce qui leur permettait de s'occuper de leur ménage et de leurs enfants. Elles étaient toutes payées à la pièce et gagnaient selon le nombre de gants produits entre 1Fr50 et 2Frs, ce qui était très peu.
Eugénie avait d'abord travaillé à l'usine mais les conditions ne lui convenaient pas et, rapidement, elle préféra coudre les gants chez elle. Pour rattraper le temps passé à préparer les repas et à faire son ménage, elle cousait une grande partie de la nuit et pour se maintenir éveillée, une cafetière chauffait en permanence sur sa cuisinière.
Hippolyte devint chauffeur-livreur. Il devait transporter, tous les jours, depuis les mégisseries de Saint-Junien les peaux qui servaient à fabriquer les gants. Anne avait commencé à coudre dès l'âge de 12 ans et avait la réputation d'être l'une des plus rapides de son atelier. Toujours penchée sur sa machine, à un âge où le corps grandit, sa silhouette s'était voûtée et le médecin qui était venu à son chevet, le jour où elle avait attrapé une mauvaise grippe, avait découvert une importante scoliose. Mais que faire lorsqu'on n'a pas d'argent sinon de travailler comme des bêtes du lundi au samedi, sans congé, sans repos!
La journée à la campagne s'annonçait bien, le soleil brillait et tous étaient ravis de se retrouver dans des lieux dont ils ne conservaient que des souvenirs heureux. Ils étaient en habit du dimanche, Hippolyte avait mis une chemise blanche à col rond sous un gilet de panne de velours et portait la cravate malgré la chaleur, Anne avait une robe de style charleston qui blousait à la taille et, audace pour l'époque s'arrêtait juste aux genoux, Elise qui n'était guère coquette s'était fait friser les cheveux et Marius qui avait ôté la cravate, avait conservé son costume de ville. Seule, Eugénie avait une tenue austère car elle portait toujours le deuil de sa mère décédée l'année précédente. Claude qui était féru en photographie avait apporté un superbe appareil en bois de citronnier et à plaques à émulsion tel qu'en possédaient les photographes professionnels. Il fallait poser l'appareil sur son trépied, disparaître derrière un voile noir et au bout de quelques secondes, si personne n'avait bougé, la photographie était prise. L'aventure était singulière car aucune personne présente ce jour n'avait, à l'exception d'Elise et de son mari, été photographiée par un amateur. Hippolyte et sa femme ne possédaient que deux photographies; l'une avait été prise juste avant la guerre de 1914 pour la communion de Marius et l'autre, en 1923, pour leur vingt cinq ans de mariage. Ces deux clichés avaient été réalisés par un photographe professionnel, dans un décor artificiel. Claude exigea que tout le monde prît la pause. Eugénie et Elise étaient assises côte à côte, la petite Claudette à leur pied. Marius pour donner plus de naturel à la scène feignait de verser du vin à son père et Anne pour paraître moins voûtée croisait ses mains dans le dos ce qui faisait pointer son ventre. Le photographe compta jusqu'à 5, on entendit un déclic et chacun put s'installer pour déjeuner. Le couvert avait été mis sur une grande nappe blanche et Hippolyte découpa un poulet qui avait été cuit la veille. Le vin provenait de la vigne de l'oncle Emile, c'était un vin d'un rouge vermillon, un peu âpre et qui laissait dans la bouche un fort goût de tanin. Marius hésitait encore à annoncer ses fiançailles, et dut attendre le dessert pour oser parler.
*J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. J'ai fait la connaissance, l'année dernière, lorsque j'étais encore à Cusset d'une jeune fille, nous nous voyons toujours et j'envisage de demander sa main à ses parents.
Hippolyte venait juste de couper la fouace et s'apprêtait à ouvrir une bouteille de mousseux.
*Voilà, en effet, une grande nouvelle mais tu ne nous as pas beaucoup parlé de cette jeune fille .
Marius fut un peu rassuré car il craignait la réaction de ses parents.
Pour être juste, il faut préciser que ceux-ci n'étaient pas tout-à-fait ignorants des projets de leurs fils car ils avaient lu une lettre adressée quelques semaines plus tôt à sa sœur où il ne faisait pas mystère de ses projets.
Eugénie voulut savoir ce que faisaient ses parents.
*Sa mère tient une boutique de quincaillerie et de couleurs à Cusset et son père est maréchal-ferrant.
Cette révélation fut bien accueillie par Hippolyte car un homme qui s'occupait des pieds des chevaux ne pouvait qu'avoir bien élevé sa fille.
*Ces gens ne sont pas trop riches? demanda Eugénie
comme si elle craignait que son fils soit corrompu par cet argent qu'ils n'avaient jamais possédé.
Marius qui comprenait leur crainte leur dit que c'était des gens modestes, qu'ils étaient peut-être un peu plus fortunés qu'eux mais sans plus.
Alors, Hippolyte qui avait gardé sa main sur le bouchon ouvrit la bouteille, remplit le verre de Marius et s'écria :
* Puisses-tu être heureux mon fils comme je l'ai été durant ma vie avec ta mère. Ton grand- père ne voulait pas que je l'épouse et j'ai preque dû l'enlever! alors toi sois aussi heureux mais si tu deviens célèbre un jour, ne renie jamais tes origines!
Et pour ne pas céder à l'émotion, il but d'un seul coup son verre et garda le silence.
La conversation fut ensuite entretenue par les femmes qui voulaient en savoir plus, comment était-elle, avait-il au moins une photographie avec lui, avait-il fixé la date des fiançailles? Anne voulait aussi savoir si elle avait un trousseau car elle-même passait ses soirées à broder ses initiales ou à faire des jours sur des draps de lin ou de métis. En ce début de siècle, la jeune fille aveyronnaise accordait toujours beaucoup d'importance au trousseau de mariage qui comprenait le linge de maison, les accessoires du lit, le chapeau de perles et le grand châle nuptial, [1]"lou moucadou noubial".
Marius était bien embarrassé pour répondre à toutes ces questions mais comme il avait sur lui une photographie de sa promise qu'il avait glissée dans la poche intérieure de son complet veston, il voulut la montrer. En la sortant il fit tomber une page d'un journal qu'un de ses camarades de faculté lui avait donnée quelques jours plus tôt. Il s'agissait d'un article de L'Humanité. Un titre en gros caractères barrait la première page : Arrestation de Pierrre Sémard, secrétaire général du parti communiste.
Si le diable avait surgi brutalement sur le pré, la famille n'aurait pas paru plus effrayée. Il faut se souvenir que dans cette contrée du Massif Central, les électeurs avaient toujours choisi des députés ou des sénateurs de droite.
Les communistes étaient considérés comme des bandits de grand chemin, anti-militaristes, anti-cléricaux. On racontait qu'ils avaient perturbé à plusieurs reprises des processions religieuses et qu'ils appelaient les conscrits à l'insubordination.
Le 7 Mars, les députés avaient adopté à une écrasante majorité la loi militaire dite Paul-Boncour. De nombreux intellectuels s'opposaient à cette loi. Emmanuel Berl, Philippe Soupault et Maurice de Vlaminck demandaient son abrogation. Un mois plus tard, le ministre de l'intérieur, le radical Albert Sarraut, affirmait : "Le communisme, voilà l'ennemi!" Les locaux du journal l'Humanité furent perquisitionnés, le gérant, Daquin de Saint-Preux emprisonné.
Hippolyte n'aurait pas pu imaginer que son fils puisse être communiste et il ne comprenait pas qu'il conserve un tel torchon, à côté de la photographie de sa fiancée.
Marius dut expliquer que c'était un ami qui lui avait donné ce journal mais que L'Humanité défendait les ouvriers, les pauvres et des gens comme ses parents qui toute leur vie avaient été exploités par des bourgeois et des capitalistes!
Hippolyte était furieux, non seulement son fils n'était pas devenu curé mais maintenant il avait des idées révolutionnaires ! Il lui rappela les événements tragiques de Decazeville au siècle dernier au cours desquels l'ingénieur Watrin fut défenestré par des révolutionnaires.
*Tu finiras comme eux sur l'échafaud!
Il fallut toute l'habileté des femmes pour que la conversation prît un tour plus enjoué. Elles se mirent à parler de la fiancée. La photographie avait été prise, à Vichy, dans le Parc des Sources. On y voyait une jeune fille en robe blanche, très élégante appuyée contre son vélo. Marius dit qu'elle se prénommait Yvonne et qu'elle venait d'avoir 20 ans. On oublia bien vite l'incident du journal, les trois hommes jouèrent aux quilles tandis que les femmes firent de la couture.
Le soir toute la famille, après avoir dîné chez l'oncle et mangé le cochon assista sur la place du village au feu de la Saint-Jean. Les enfants avaient constitué avec des sarments et des branchages un énorme foyer qui s'embrasa en crépitant lorsqu'on y mit le feu. Le curé appelé en renfort fit quelques prières pour saluer l'arrivée de l'été et demanda aux saints protecteurs de favoriser les récoltes. Puis un joueur de cabrette qui venait de Saint-Flour fit gémir son instrument, rythmant avec le son de grelots fixés à ses chaussures des bourrées endiablées, des [2]crouzaos et des tournjairos qui durèrent jusqu'au petit matin.
Marius prit le train de Clermont le lendemain.
Il ne revit jamais son père vivant. Un soir de septembre, Hippolyte qui n'avait jamais été malade se mit brutalement à tousser et se plaignit de violentes douleurs dans la poitirine, il dut s'aliter et mourut quelques jours plus tard d'une maladie que le médecin prit pour une fluxion de poitrine. Une année, jour pour jour après le déjeuner sur l'herbe, Anne qui revenait d'une promenade en vélo des gorges de la Jonte éprouva elle aussi les mêmes symptômes et les mêmes douleurs dans la poitrine; son agonie dura de longs mois, le médecin décela cette fois une tuberculose pulmonaire et elle mourut le jour du printemps.
Chapitre 4...